
La photographe Olivia Gay.
Olivia Gay, photographe « des femmes debout »
Pour celles et ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de le voir, pouvez-vous présenter votre travail exposé actuellement ?
C’est un ensemble de photos de femmes à leur poste de travail : à l’usine, à la caisse du supermarché, ou sur leurs propres terres quand il s’agit d’agricultrices. Elles ont été réalisées à des périodes différentes durant une dizaine d’années, bien avant #MeToo et tout ce qui a fini par éclater, mais on voit une tension intérieure, tue, et des femmes qui résistent grâce à leur activité. C’est une manière de montrer des femmes debout, comme François Ruffin avec son film Debout les femmes - que je viens de voir et que je vous conseille !

Comment en êtes-vous venue à vous intéresser à ces femmes ?
J’ai quitté Paris au début des années 2000 pour m’installer dans l’Orne. Après avoir grandi en ville, notamment aux États-Unis, je me suis retrouvée dans cet environnement que je n’avais jamais connu, entourée d’un certain vide. Je travaillais pour la presse à ce moment-là, je suis donc allée à la recherche de sujets et c’est comme ça que j’ai commencé, de fil en aiguille, à photographier des femmes. J’écoutais ce qu’elles me racontaient de leur vie, leurs difficultés à trouver un travail, à le garder aussi puisqu’à partir de 2008 de nombreuses usines ont commencer à fermer. J’ai été invitée par une voisine à rencontrer ses collègues lors d’un piquet de grève, et c’est en discutant avec elles que j’ai découvert ce que c’était de vivre en tant qu’ouvrière. C’est un mot très fort qui a une connotation négative, qui enferme et peut être très violent ; toutes trouvaient d’autres formules pour l’éviter ou disaient : « Y’a pas pire, on a honte, on est considérées comme le bas par la société, etc. » L’idée était de créer à partir de ce mot « ouvrière », des images, au sens esthétique (lumière, couleurs, etc.), des photographies-peintures empreintes d’histoire de l’art, et de jouer sur le contraste pour montrer qu’il est possible d’y trouver quand même une certaine beauté. Il y a aussi des photos de dentellières d’Alençon : un métier considéré comme plus noble, très valorisé, qui renvoie à des savoir-faire anciens… et dont le salaire est pourtant le même qu’à l’usine.
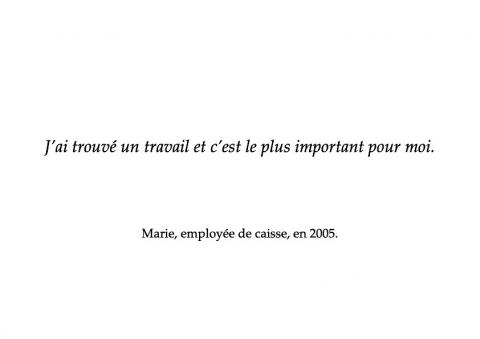
Les femmes que vous photographiez ne font donc pas que poser, elles sont partie prenante dans votre processus ?
La photographie est beaucoup plus riche à partir du moment où on invite la personne concernée à prendre place, à participer à la construction des images. Donc bien sûr, c’est un travail qui part d’elles et des nombreux échanges sur la façon dont elles avaient envie d’être montrées. Je sentais qu’il y avait une fierté à être regardées au travail, quel que soit le domaine, à être vues dans ce soin qu’elles portent à leur ouvrage, quoi qu’elles fassent. Et puis j’ai aussi passé du temps avec elles pour comprendre leurs vies, du temps entre les prises de vues pour boire le café le matin, faire une pause cigarette ou fêter un anniversaire.
Un jour, j’ai gagné un prix à l’étranger et je me suis retrouvée dans la suite d’un hôtel 4 étoiles… parce que j’avais photographié des femmes ouvrières. Ce n’est pas du tout la raison pour laquelle j’avais fait ces images ! Ça a renforcé encore plus ma détermination à comprendre ce que peut produire la photo. À quoi, à qui ça sert ? L’image, ce n’est pas seulement une trace, c’est ce qui nous relie à la personne photographiée. L’image, c’est la relation humaine en elle-même. Pour moi, la photo mène de la compréhension à l’action.

C’est ce que vous appelez la « photographie compréhensive » ?
Oui. On pense que l’image est seulement un instant, quelque chose de fini, mais pour moi c’est surtout une durée. À travers la photo, la relation – aux autres, humain·e·s ou non, à ce qui nous entoure – reste vivante, devient éternelle, et ces relations sont ce qu’on a de plus important sur terre. C’est pour ça que la photo est souvent associée à la mort, à la disparition ou à l’absence. En ce moment, je travaille auprès d’infirmièr.e.s à domicile dans le Tarn et une femme de 92 ans m’a dit justement une phrase qui m’a marquée à ce sujet. Elle me faisait visiter dans son salon ses photos de famille posées sur le buffet ou accrochées au mur, en m’expliquant pourquoi elle les avait agencées de cette manière, comme si elle me faisait visiter son musée à elle. Puis elle m’a dit : « Et oui, à la fin, c’est tout ce qu’il nous reste, les photos ! » Les photos sont la mémoire vive, vivante.
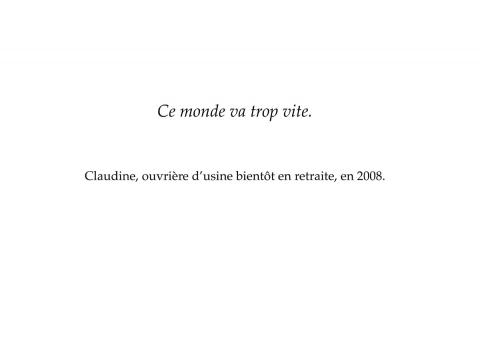
Vous êtes engagée dans le programme doctoral de recherche et de création artistiques RADIAN, porté depuis 2018 par l’ésam Caen/Cherbourg. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
C’est l’occasion pour moi de revenir sur le travail accompli jusqu’ici, sur lequel je n’avais pas encore trouvé le temps de réfléchir. L’enjeu de ce doctorat est de créer une oeuvre et de produire un journal de bord et un écrit théorique. Mon projet de recherche s’intitule : « Women at work, Pour une photographie compréhensive », et mon projet de création portera sur le travail en cours avec une petite équipe d’infirmières qui travaillent à domicile en milieu rural, dans une commune du Tarn de1300 habitant·e·s. Comme pour chaque projet, il y a une restitution sur place, des échanges avec les personnes concernées (les infirmières, les patients et leurs familles, les habitants). Deux expositions sur place ont déjà eu lieu. Une prochaine est prévue pour rayonner plus largement, de ce microcosme au reste de la communauté humaine.

Quels sont vos projets à venir ?
Je vais photographier des chercheuses en sciences de la nature et sciences formelles à l’université de Caen, et poursuivre à Rennes 2 avec des chercheuses en sciences humaines et sociales. C’est un domaine que je ne connais pas du tout, même si je suis doctorante donc chercheuse moi aussi. Que met-on derrière ce mot ? Qu’est-ce que ça induit sur la vie professionnelle et aussi privée ? Comme pour chaque projet, j’y vais à l’aveugle – paradoxal pour une photographe ! – et ça me laisse toute la place pour découvrir et inventer des images, au-delà de la femme en blouse blanche avec sa pipette pour les scientifiques. Des masterclass sont aussi prévues, dans le cadre des programmes sur l’égalité femmes-hommes, pour se questionner sur la visibilité des chercheuses : pourquoi sont-elles moins vues et comment les montrer ?
Vous êtes chercheuse à Rennes 2 et intéressée pour prendre part à ce projet ? Contactez avant le 8 décembre 2021 Sarah Dessaint, chargée de mission égalité, par mail : sarah.dessaint [at] univ-rennes2.fr (arah[dot]dessaint[at]univ-rennes2[dot]fr)
